Cinq questions sur la réforme du Code du travail voulue par Macron
Chantier prioritaire de ce début de quinquennat, la réforme du Code du travail est déjà controversée après la divulgation de différents documents dans la presse.


Avec la consensuelle loi sur la moralisation de la vie politique, la réforme du Code du travail est "le chantier prioritaire" d'Emmanuel Macron. Bien que soumis à négociations, le texte que concocte le gouvernement d'Edouard Philippe risque bien de bouleverser vos droits, que vous soyez salarié ou employeur. Alors que différents documents ont déjà fuité dans la presse, franceinfo répond à cinq questions que vous êtes susceptible de vous poser.
Quelles sont les pistes évoquées à propos des licenciements ?
La loi El Khomri prévoyait déjà qu'une entreprise puisse procéder à des licenciements économiques dès lors qu'elle était confrontée à une baisse de commandes, de chiffre d'affaires ou encore à une dégradation de sa trésorerie. Ces difficultés doivent être observables sur au moins un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, et jusqu’à quatre trimestres consécutifs pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Cette fois-ci, le projet porté par le gouvernement va beaucoup plus loin. Selon Libération, parmi les "pistes" sur lesquelles l'administration "doit plancher" figure la possibilité de négocier, à l'échelle de l'entreprise, le motif du licenciement. Concrètement, pour les commerciaux, par exemple, des objectifs chiffrés pourraient être définis dès l'embauche et justifier le licenciement s'ils ne sont pas atteints.
La mesure, qui n'a pas été confirmée par le gouvernement, ne passe pas auprès du syndicat FO. "Si certains motifs de licenciement peuvent être discutés en entreprise, c'est 'open bar'", a martelé Jean-Claude Mailly sur Europe 1, insistant sur le fait que "ce n'est pas en facilitant le licenciement économique qu'on va faciliter l'embauche".
En cas de licenciement abusif, les indemnités vont-elles baisser ?
Pas forcément. Emmanuel Macron souhaite "réduire l’incertitude sur les coûts de licenciement" pour les entreprises en instaurant un plancher et un plafond pour les indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (hormis les cas de discrimination, de harcèlement, etc.). Depuis la loi El Khomri, un barème existe, mais il est seulement indicatif.
Dans ce barème, les montants indicatifs des indemnités s'échelonnent entre un et 21 mois et demi de salaire en fonction de l'ancienneté. Mais dans les faits, "c'est à l'appréciation du juge de décider du montant des indemnités", explique à franceinfo l'avocat spécialisé en droit du travail Thomas Godey. Par exemple, le montant versé par l'employeur ne sera pas le même si le salarié a retrouvé du travail ou non, si l'entreprise est coutumière de ce genre de licenciement, ou plus simplement en fonction de la taille de l'entreprise. Les montants peuvent varier du simple au triple, précise Le Figaro.
Emmanuel Macron souhaite donc instaurer un plancher ou un plafonnement obligatoire avec pour objectif de réduire le contentieux. Concrètement, lorsqu'une entreprise souhaitera se séparer d'un salarié, elle saura précisément combien cela lui coûtera, et pourra ainsi le prévoir. Au détriment du salarié ? Pas forcément, puisque ce dernier saura également ce qu'il touchera de manière certaine et sans les aléas d'une procédure. "Si l'entreprise sait qu'elle doit par exemple verser dix mois de salaire d'indemnité à l'un de ses employés, elle le fera plus rapidement", anticipe l'avocat, et sans se lancer dans un bras de fer coûteux.
Reste qu'il faut encore déterminer un barème. Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et pour une ancienneté supérieure à deux ans, les indemnités prud’homales ne peuvent pas être inférieures à six mois de salaire. Un plancher que le cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, cité par Libération, se dit prêt à "rabaisser". L'idée de rendre ce barème obligatoire rencontre l'opposition de certains syndicats, notamment la CGT. D'autres sont prêts à négocier moyennant des contreparties, rapporte Le Figaro. "Si jamais il y a un plafond, on regardera le niveau de ce plafond", a ainsi déclaré le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly.
Pour le professeur de droit du travail Emmanuel Dockes, interrogé par franceinfo, c'est en revanche un bouleversement total et dangereux. "Ici, l'objet n'est pas de plafonner les indemnités de licenciement justifié. Mais rendre la sanction parfaitement prévisible en cas de licenciement sans motif. Lorsque vous avez un plan de départs volontaires, les salariés partent souvent avec au moins un an de salaire, mais avec leur accord. Là, on pourra virer les gens d'un coup de tête, sans aucune justification à apporter et sans risque financier", s'alarme-t-il.
Les accords d'entreprise vont-ils primer sur les accords de branche ?
Non, assure le gouvernement. Depuis l'entrée en vigueur de la loi El Khomri, un accord d’entreprise sur le temps de travail peut certes être négocié et être moins avantageux qu’un accord de branche, dans les limites du Code du travail. Mais pour être validé, il doit recueillir l’accord des syndicats représentant plus de 50% des salariés. Emmanuel Macron veut aller plus loin en généralisant cette primauté des accords d'entreprise à d'autres domaines, comme le contrat de travail, le salaire, la sécurité ou la santé.
"Demain, les accords dérogatoires pourraient porter par exemple sur les primes spécifiques imposées par certains accords de branche (prime de panier, prime de repas, prime d'équipes....). Une entreprise pourrait ainsi décider de supprimer certaines de ces primes", notent Les Echos. "C’est seulement à défaut d’accord d’entreprise que la branche interviendra", précisait Emmanuel Macron dans son programme présidentiel. Le nombre de branches devrait aussi être réduit d’environ 700 à un nombre compris "entre 50 et 100".
Mais la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a précisé un élément essentiel : "La branche continuera à avoir un rôle d'encadrement." "Ce sera à elles de se mobiliser pour fixer des limites. C'est un bon moyen d'en réveiller certaines complètement sclérosées, comme celle de la publicité", analyse l'avocat Thomas Godey.
Il faudra attendre le résultat des négociations pour connaître le périmètre des accords négociables au niveau de l'entreprise ou des branches.
Le référendum d'entreprise ne risque-t-il pas d'entraîner un chantage à l'emploi ?
C'est un des effets pervers dénoncés par les opposants au référendum d'entreprise, que le président veut pouvoir confier aux chefs d'entreprise. Petit rappel : le gouvernement veut donner la possibilité d'organiser des référendums internes aux patrons, et non plus seulement aux syndicats, comme c'est le cas depuis la loi El Khomri. Initialement, cette possibilité devait être soumise aux mêmes conditions que celles prévues dans la loi Travail : que le projet d’accord ait au préalable reçu l’aval de syndicats représentant au moins 30% des voix.
Mais, selon les documents obtenus par Libération, le gouvernement veut aller là aussi bien plus loin. Un patron pourrait solliciter un référendum si "un accord a été soumis à la négociation, mais n’a pas été conclu". C'est-à-dire sans le soutien d'une majorité des syndicats. Seule la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) pourrait ne pas valider la procédure. Mais en cas d'avis favorable, l’employeur aura la possibilité de lancer le vote. Et s'il reçoit une majorité de voix, l'accord sera validé, peu importe l'avis des syndicats majoritaires, explique Le Parisien.
Les adversaires de ce projet craignent que les patrons n’exercent un "chantage à l’emploi" sur les salariés. Ce fut le cas lors du référendum organisé à l'usine Smart de Hambach, en Moselle. Le 16 décembre, plus de 90% des salariés du site ont accepté de travailler 39 heures payées 37 pour éviter que leur usine ne soit transférée en Slovénie. Mais beaucoup ont voté oui par résignation. "On n'a pas le choix, c'est tout. C'est la conjoncture, c'est comme ça", déclarait un salarié au micro de France 2. "Le but, c'est de garder son emploi, je pense", ajoutait un autre.
Pour Thomas Godey, cette possibilité offerte aux patrons est logique, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent faire des sondages pour faire avancer les négociations, comme ce fut le cas pour le travail de nuit dans les magasins Sephora. L'avocat tient également à rappeler qu'avant de lancer tout référendum, un accord d'entreprise préalable aura été discuté entre la direction et les syndicats.
Qui représentera les salariés ?
Les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : autant d'instances appelées à fusionner avec la réforme. Une mesure réclamée depuis longtemps par le Medef. Depuis 2015 et la loi Rebsamen, cette délégation unique du personnel (DUP) n'est possible que dans les entreprises de 50 à 299 salariés, sur simple initiative de l'employeur. Au-dessus de 300 salariés, il faut un accord majoritaire. Mais la mesure n'a été que rarement appliquée.
Outre la recherche d"'efficacité" du dialogue social, l'objectif est d'encourager l'emploi. Aujourd'hui, à partir de 11 salariés, un patron se voit obligé d'organiser une élection de délégués du personnel. Puis, au delà de 50 salariés, c'est le comité d'entreprise et le CHSCT qui deviennent obligatoires. Des contraintes qui freinent certains patrons au moment de faire grossir leur entreprise. La DUP vise à éliminer ces effets de seuil : n'importe quelle société, quelle que soit sa taille, pourrait être dotée de cette instance unique et n'hésiterait théoriquement plus au moment d'embaucher.
La fusion des représentants syndicaux, désignés par les organisations syndicales, et les représentants élus inquiète le professeur de droit du travail Emmanuel Dockes. Selon lui, "il s'agit de remettre en cause cette grande conquête de Mai-68 qui permet aux organisations syndicales d'avoir des représentants dans l'entreprise. Les supprimer, pour un gouvernement qui prône le dialogue social, c'est proprement hallucinant."
Thomas Godey y voit un autre effet, peu évoqué jusque-là dans le débat et qui devrait alerter davantage les syndicats : "Du point de vue des investisseurs étrangers, c'est le moyen de diminuer le nombre d'interlocuteurs. C'est donc une barrière qui saute. Là où aujourd'hui il y a 20 salariés protégés, demain ils ne seront peut-être que 15." Un bon argument pour attirer des investisseurs d'outre-Manche échaudés par le Brexit, estime l'avocat.

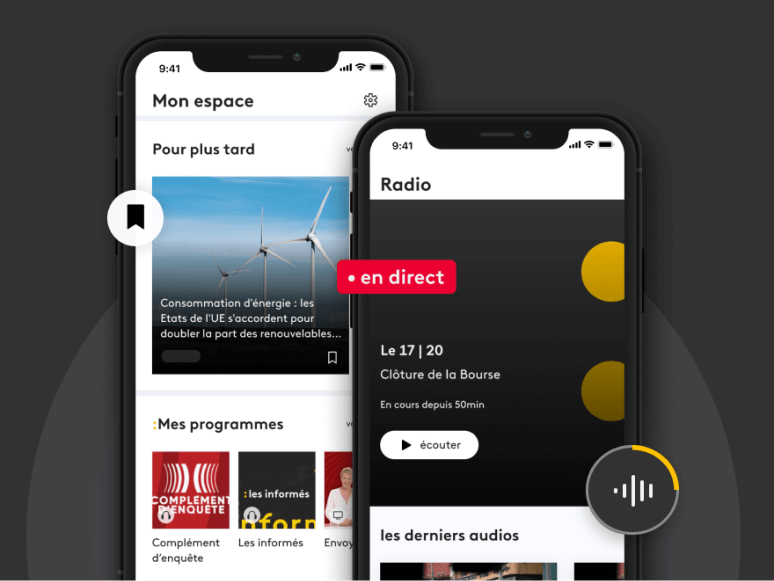

Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.