Femmes réfugiées à Cergy : "En Syrie, nous étions morts, de toute façon"


Nohma, Najah et Hiba racontent à francetv info les vies très différentes qu'elles ont menées, avant de devenir des "réfugiées".
Dans un coin de la cour du centre Hubert-Renaud, à Cergy (Val d'Oise), un homme sourit à l'écran de son téléphone, en répétant "Baba ! Baba !" Son haut-parleur laisse entendre le rire de son bébé, probablement resté en Syrie avec sa mère. Un peu plus loin, un homme sans âge, le dos voûté sous un épais manteau d'hiver, fume une cigarette, l'air hagard, sous le ciel gris. A une trentaine de pas derrière lui, sous une grande tente blanche, une professeure bénévole enseigne à de grands débutants les subtilités de la langue française : "On écrit 'garçon'. Ça ne se dit pas 'gar-kon', mais 'gar-ssson'."
Parmi les réfugiés arrivés à Cergy, mercredi dernier, les femmes sont discrètes. Moins nombreuses que les hommes peut-être, elles maîtrisent surtout moins les langues étrangères. Certaines ont déjà accordé dix interviews à la presse, mais l'anglais les intimide et le français semble encore bien compliqué ; les cours n'ont commencé que la veille. Un "bonjour" en arabe les rassure, déclenche un sourire.
Hiba et Samah, inséparables footballeuses
Assises sur un muret, Hiba et Samah semblent attendre quelqu'un ou quelque chose. Au milieu des familles et des hommes venus seuls, leur allure détonne. Les cheveux clairs et courts de la première et le chignon rock de la seconde les font passer pour des bénévoles plutôt que des réfugiées.
Mon salut en anglais les sort du silence, à contrecœur. Hiba, 24 ans, me regarde à peine, blasée d'entendre une fois encore les mêmes questions, qu'elle anticipe, machinalement : "Pneumatique... écoper... marche..." Son amie Samah, à peine plus âgée, écoute d'une oreille, nonchalante. La conversation est laborieuse.
"Est-ce que vous avez envie de rester en France ?
– Pourquoi tous les journalistes me posent la même question ? Vous voulez que je m'en aille ?
- Parce que, si j'avais dû quitter mon pays, ma famille, je rêverais probablement de les revoir un jour...
- Vous voudriez vraiment retourner dans un pays entré en guerre pour au moins vingt ans ?"
Il y a un mélange de rage et de lassitude dans sa voix, mais elle reprend son récit : "On ne veut pas être des mendiants ici !" Hiba s'enorgueillit d'être "indépendante financièrement depuis l'âge de 16 ans". Encouragées à quitter Alep par leurs parents, "inquiets, quand même", Hiba et Samah sont parties "pour l'avenir, les études, le travail".
Quand elles se sont retrouvées à Istanbul, elles ont travaillé toutes les deux pendant plusieurs mois comme "couturière, guide touristique". Rien à voir avec leur formation, en informatique pour Hiba et en chimie pour Samah. Elles ont décidé de rejoindre l'Europe, il y a un mois environ, "avant l'hiver, parce que la mer devient alors impraticable". Elles pensaient s'arrêter en Allemagne, ou bien pousser le voyage jusqu'en Angleterre. Finalement, c'est à Cergy que leur longue route s'est arrêtée.
Mais le discours de Hiba tranche avec l'insistante reconnaissance de la majorité de ses compagnons d'infortune envers les autorités françaises. Si bien que, derrière nous, Ali lance en riant : "Il ne faut pas lui parler à elle, elle crée des problèmes !" Hiba soupire. Invité dans la discussion, Ali, ancien étudiant en philosophie reconverti en agriculteur, évoque avec elle "les Européens qui généralisent 'musulmans = extrémistes'." Encore très remontée, Hiba me rappelle que "l'extrémisme est partout, pas seulement chez nous", et prend pour exemple le nazisme, "un extrémisme qui n'a vraiment rien à voir avec l'islam".
"Comment vous êtes-vous rencontrées ?" interrompt mon interprète. "Au foot", répondent Hiba et Samah. Les deux jeunes femmes jouent ensemble depuis 2009. Le soir même, quelqu'un doit les emmener au stade des Maradas, à Cergy, où s'entraîne l'équipe féminine locale. Samah, blessée au poignet, ne pourra pas jouer. Elle veut aller au stade quand même. Les deux jeunes femmes ne se quittent pas et redoutent d'être envoyées dans des villes différentes. "Samah est ma famille maintenant, s'ils nous séparent, je veux que tous les journalistes écrivent que ce n'est pas normal", s'emporte Hiba. C'est noté.
Nohma et Tarek, famille modèle
De loin, Nohma ressemble à une lycéenne, absorbée par le smartphone qu'elle serre dans ses mains et ne quitte pas des yeux. Une grosse écharpe violette voile ses cheveux, son corps de jeune fille est enfermé dans une courte parka grise.
Nohma a en fait 29 ans, un mari et trois filles, Faten, Sima et Syline. Cette famille syrienne a tout abandonné pour rejoindre l'Europe. Le couple avait "une bonne situation", à Homs. Nohma travaillait dans l'administration d'un centre de santé public. Son mari, Tarek, âgé de 38 ans, était infirmier anesthésiste. Ils avaient une maison, une voiture, "de beaux meubles". Pendant que son épouse nous raconte l'histoire familiale, ce grand gaillard aux épaules solides suit un cours de français, avant de la rejoindre pour s'occuper des filles.
En Syrie, Nohma a longtemps "cru que la situation allait s'améliorer". Tarek avait participé aux premières manifestations pacifistes, en 2011, "pour plus de liberté", précise-t-elle. Elle a été surprise par la visite de François Hollande à Cergy, à leur arrivée : "En Syrie, Assad aurait été suivi de dizaines d'agents des renseignements, c'était étouffant." Mais les marches pour la liberté ont tourné court. "La répression armée a renforcé l'engagement de Tarek, mais, au bout de six mois, des armes ont commencé à circuler et les manifestations n'avaient plus grand-chose de pacifiste. Personne n'osait plus dire ce qu'il pensait, de peur d'être tué, quelles que soient ses opinions", se souvient-elle. "La révolution n'avait plus aucun intérêt."
Pas question pour autant de quitter le pays tout de suite. De Homs, Nohma et Tarek sont partis pour la capitale, Damas, puis Alep, en 2012, avant de revenir dans leur ville. "Neuf fois, nous avons déménagé, neuf fois, nous avons recommencé à zéro", compte Nohma, "dans des logements toujours plus chers". Et plus rares, car "il ne reste que trois quartiers habitables" à Homs et "quatre hôpitaux, privés, sur les 22 que comptait la ville". Sima, 3 ans et demi, est née alors que les combats faisaient rage. L'hôpital n'avait plus de nourriture. La mère et le mari de Nohma ont dû arpenter le quartier pour trouver des épinards et du lait, payés au prix fort.
Dans un flot de paroles ininterrompu, Nohma raconte à mon interprète, franco-syrienne, "les avions qui tournent sans arrêt dans le ciel, qui bombardent, les milices qui enlèvent des gens, réclament des rançons et ne rendent que des cadavres, les snipers partout, l'armée qui enrôle tous les hommes". Les amis de Tarek commençaient à être tous appelés, un par un. Le couple a donc pris la route, et embarqué sur l'un des "bateaux de la morts", direction l'Europe, "parce qu'il n'y avait plus d'argent, plus d'avenir", ni pour eux ni pour leurs enfants.
Ils n'avaient pas envisagé de s'installer en France. Mais l'accueil qui leur a été fait, "la générosité, l'humanité", les ont soulagés. "C'est comme en Syrie, avant", reconnaît Nohma, les yeux humides. Maintenant qu'ils sont là, la jeune femme veut "juste une vie normale, un endroit à nous".
Najah et Yasser, drôles d'amoureux
"Moi, je rêve de manger des mehchi !
- Et moi des cuisses de poulet frit..."
Le souvenir des légumes farcis du pays parfumerait presque la terrasse sur laquelle Najah et Yasser font connaissance avec d'autres réfugiés. Leurs éclats de rire attirent l'oreille. Ils taquinent et imitent une Irakienne "qui veut paraître plus jeune, en croisant les jambes comme ça". Najah, qui porte un foulard imprimé panthère sur la tête et les épaules, toussote et renifle. Les traits fatigués de cette petite bonne femme de 37 ans lui donnent cinq ou dix années de plus. Mais ses clins d'œil malicieux et ses mains qui s'agitent quand elle parle lui en enlèvent autant.
Assis côte à côte sur un banc de bois, ils se chamaillent, se pincent les joues, s'embrassent, en évoquant leur "mariage d'amour", en mai 1999. Elle vivait à Raqqa, lui à Homs. La famille de Yasser n'était pas vraiment d'accord avec cette union, "mais elle avait arrêté de manger, tellement elle était amoureuse de moi ! Autant d'amour, cela ne se refuse pas", raconte-t-il. "Mais j'aimerais bien épouser une Française blonde aux yeux bleus, maintenant, pour faire de beaux enfants", rit Yasser, laissant voir ses grosses incisives jaunies par le tabac. Najah feint la jalousie, me sourit.
Il y a environ un an, ces deux amoureux ont quitté Raqqa pour la Turquie, à contrecœur. Dans cette grande ville du Nord, tombée en 2013 aux mains des groupes de combattants islamistes, "nous n'étions plus libres, nous n'avions même plus le droit de porter des jeans", gesticule Najah. Alors que les islamistes s'affrontaient pour gagner le contrôle de Raqqa, le régime a bombardé la ville, tuant les deux enfants de Najah et Yasser. Puis les jihadistes de l'Etat islamique sont arrivés et le couple s'est décidé à fuir :"Nous étions morts, de toute façon. Alors à Raqqa ou sur la route..."
Pour rassembler quelques économies, Yasser a vendu son taxi et Najah a dû se délester de tout son or, que les Syriens offrent à l'occasion des mariages et achètent, comme une valeur refuge, dès qu'ils ont un peu d'argent de côté. Ils racontent, quasi-mécaniquement, en se coupant mutuellement la parole, leur voyage. Le bateau pneumatique qui s'est retourné cinq fois, les bagages perdus, l'argent volé, les passeurs malhonnêtes…
Moi, j'ai voulu faire demi-tour, mais Yasser me disait toutes les cinq minutes 'Regarde, c'est la côte grecque !'
Arriver à Cergy, "c'est comme un film qui se termine". Mais certaines angoisses persistent. Tous les matins, au petit déjeuner, Najah, Yasser et les autres réfugiés se racontent leurs cauchemars. "Quand je ferme les yeux, je revois les frontières, la police", explique Najah, qui a encore peur quand elle entend un avion passer. Et son film n'est pas tout à fait fini. Ils attendent encore de recevoir leur carte de séjour, avant de quitter le centre d'accueil pour un logement, dans une ville inconnue. "Moi, je pourrais rester ici, on dort bien", dit Najah.
Un responsable du centre d'accueil passe près de nous. Najah articule "Bonjour ! Merci beaucoup !", les seuls mots de français qu'elle connaisse déjà. Najah ne sait pas lire, "mais j'apprends très vite". Elle n'a "jamais travaillé ni fait un effort physique" de sa vie, mais elle est prête à travailler "si on peut trouver quelque chose à faire ensemble ici".

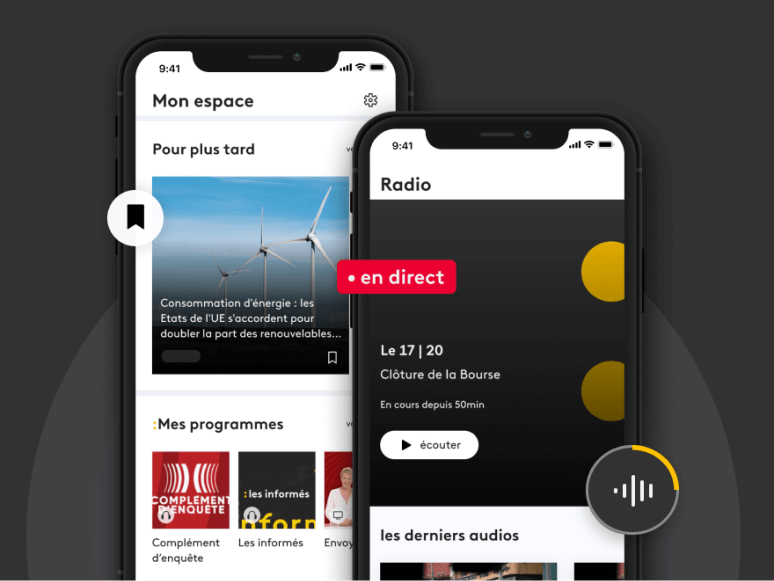

Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.