Election présidentielle : "Une lutte entre la Tunisie de la rente et celle des jeunes entreprises"
Le 2e tour a opposé deux candidats, le patron de Nessma TV Nabil Karoui et l'universitaire Kaïd Saïed. Tous deux ont souvent été présentés comme "antisystème". Mais le sont-ils vraiment ? L'analyse de l'universitaire Mounir Kchaou.


La vague du "dégagisme" a déferlé sur la Tunisie, comme le montre le second tour de la présidentielle, avec deux candidats qui ont mis KO les 24 autres souvent issus du "vieux monde" de la classe politique tunisienne traditionnelle. Mais peut-on considérer que Nabil Karoui et Kaïs Saïed sont les représentants d'un "nouveau monde" à la tunisienne ? Quelles évolutions ce phénomène traduit-il ? franceinfo Afrique a demandé son point de vue à Mounir Kchaou, professeur de philosophie politique à l'unversité de Tunis. Une analyse souvent décapante du "mal tunisien".
franceinfo Afrique : comment analysez-vous la situation politique aujourd'hui dans votre pays ?
Mounir Kchaou : la Tunisie est une démocratie naissante. L'on y constate un manque d'expérience, de visibilité, de lisibilité de la classe politique. Il est frappant de voir l'émergence de mouvements politiques qui disparaissent en un temps record. C'est par exemple le cas du parti Nidaa Tounès lancé en 2012 (par l'ancien président Béji Caïd Essebsi), qui a remporté en 2014 la présidentielle et les législatives. Et qui s'est très vite désintégré.
Alors pourquoi ? On peut y voir un processus de "destruction créatrice", comme disent les économistes, de sélection naturelle, de signe d'immaturité. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'un manque de maturité, d'un manque d'ancrage naturel des partis politiques. Ceux-ci sont encore absents à l'intérieur du pays, dans les zones rurales défavorisées, à l'exception d'Ennahdha (le parti d'inspiration islamiste, NDLR). Ces partis ne sont donc pas en capacité d'encadrer les Tunisiens. Ils rencontrent surtout un écho auprès des personnes sécularisées, libérales (qui prônent les valeurs de l'individu). Ils sont concentrés dans les régions littorales et urbaines, là où ils trouvent leurs ressources.
Or, que constate-t-on aujourd'hui ? Ceux qui l'emportent dans les scrutins sont ceux qui ont trouvé des relais à l'intérieur du pays, qui parlent aux électeurs le langage qu'ils comprennent. D'où ces discours populistes qui instrumentalisent les aides sociales.
Vous visez évidemment Nabil Karoui... Mais comment analysez-vous le phénomène que vous qualifiez de "populiste" ?
Je dirais que c'est un cocktail. La Tunisie est une jeune démocratie. Et dans le même temps, elle n'est pas à l'abri d'une situation mondiale où la tendance générale n'est pas à la modération ni favorable à la démocratie.

Il s'agit d'un phénomène relativement nouveau. C'est une réaction contre la classe politique et l'establishment anti-occidental. Derrière, il y a toujours une revendication d'identité. Il y aussi l'expression d'un regret face à des choses qui devraient se faire mais ne se font pas.
C'est à dire ?
Je vous donne un exemple : le fait que l'arabisation ait été interrompue. Dans ce contexte, l'arabe n'est pas toujours considérée comme une langue nationale. Ainsi, dans les médias, on parle arabe et français. Dans le même temps, l'enseignement en français, notamment pour les sciences, peut devenir un facteur d'échec, notamment dans les quartiers populaires où l'on parle de moins en moins cette langue. Résultat : les enfants peuvent décrocher.
Il y a donc là une revendication d'identité et un rejet de l'establishment qui peuvent trouver des expressions extrêmes, comme le fait que la France continuerait à nous coloniser. C'est le sens de la polémique autour de la concession de la société Cotusal pour l'exploitation du sel. Ce n'est pas un enjeu important. Mais cela sert à dire qu'on dilapide nos ressources, même si cela n'a rien à voir avec la réalité. On joue ainsi sur le sentiment nationaliste. Comme en Europe, où l'on joue avec l'immigration.
N'y a-t-il d'autres ressorts pouvant expliquer ce phénomène ?
Il y a aussi la faiblesse et la médiocrité du débat public dans ce pays. En France, beaucoup d'intellectuels interviennent dans les médias. Le débat est de qualité, la parole est ouverte, on porte la contradiction. En Tunisie, au contraire, il n'y a pas forcément de médias matures, capables d'analyses. Dans ce contexe, les sentiments exacerbés trouvent plus facilement prise.
Comment voyez-vous l'avenir ?
Je ne peux pas prétendre à une vision claire de l'avenir. En Tunisie, la démocratie est faible, comme dans l'est de l'Europe. De plus, on constate un discours anti-libéral d'une partie de l'élite, qui tient parfois des discours d'extrême gauche à la Mélenchon et se prononce pour un anti-impérialisme radical opposé à la mondialisation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas sortir de la mondialisation. Et il n'est pas question de revenir au protectionnisme.
Pour y remédier, je pense qu'il faudrait mettre en application l'article de la Constitution sur les pouvoirs locaux. Et ce afin que les gens puissent décider de leur sort au niveau local grâce à des transferts de compétences.

On pourrait aussi parler de ce que nous appelons "la compensation", c'est-à-dire les subventions pour l'essence et les produits de base. Subventions qui profitent à tous, et pas seulement aux défavorisés. Notamment à ceux qui roulent dans de grosses cylindrées ! On peut aussi évoquer toutes ces entreprises publiques, comme Tunisair, qui perdent de l'argent et qui sont impossibles à réformer. Et qu'il faudrait privatiser
Bref, le modèle actuel va dans le mur ! Il faut soulager l'Etat qui manque de ressources. Alors que l'argent existe en Tunisie. Regardez un secteur public comme celui des phosphates (l'une des richesses du pays, NDLR) : il est pris à la gorge par les syndicats.
Il faut changer le modèle d'Etat, ce vieil Etat socialiste remontant à Bourguiba. C'est une révolution culturelle. Mais c'est la vraie révolution, indispensable pour consolider la démocratie.

Les choses commencent à bouger avec les pressions du FMI et du monde des affaires tunisiens, notamment celui des startups. Ce sont les pressions de la réalité. On assiste ainsi à une lutte entre la Tunisie de la rente et celle des jeunes entreprises.

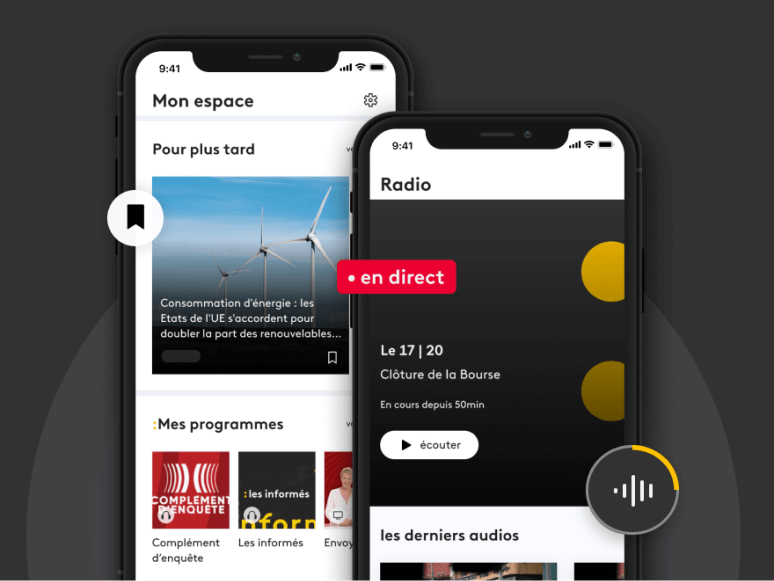

Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.